- Home
- Gustave Flaubert
Complete Works of Gustave Flaubert
Complete Works of Gustave Flaubert Read online
THE COMPLETE WORKS OF
GUSTAVE FLAUBERT
(1821-1880)
Contents
The Novels
MEMOIRS OF A MADMAN
MADAME BOVARY
SALAMMBÔ
SENITMENTAL EDUCATION
BOUVARD AND PÉCUCHET
The Short Stories
ŒUVRES DE JEUNESSE
THREE TALES
THE DANCE OF DEATH
NOVEMBRE
The Poetry
THE TEMPTATION OF SAINT ANTOINE
The Plays
THE CANDIDATE
THE CASTLE OF HEARTS
LE SEXE FAIBLE
Selected Non-Fiction
ABOARD THE CANGE
OVER STRAND AND FIELD
THE GEORGE SAND-GUSTAVE FLAUBERT LETTERS
The Trial
THE PUBLIC vs. M. GUSTAVE FLAUBERT
The Criticism
GUSTAVE FLAUBERT: A STUDY by Guy de Maupassant
Extract from ‘FIGURES OF SEVERAL CENTURIES’ by Arthur Symons
Extract from ‘ESSAYS IN LONDON AND ELSEWHERE’ by Henry James
Extracts from ‘PHOENIX: THE POSTHUMOUS PAPERS’ by D.H. Lawrence
Extracts from Virginia Woolf’s diary
The Biography
THE LIFE-WORK OF FLAUBERT by G. A. Mounsey
The French Texts
© Delphi Classics 2012
Version 1
THE COMPLETE WORKS OF
GUSTAVE FLAUBERT
The Novels
The birthplace of Gustave Flaubert, Rouen
Flaubert’s birth certificate
Flaubert by Eugène Giraud, 1880
MEMOIRS OF A MADMAN
This autobiographical short novel was written in 1838, but only first published in La Revue Blanche from December 1900 to February 1901, over twenty years after Flaubert's death. The novel alternates between the narrator's musings on the present and his memories of the past. In the sections that deal with the present, the narrator takes a bleak outlook on life, discussing writing, sanity, and death.
Unfortunately this novel has only been translated in recent years and so cannot appear in the collection. However, a free non-profit making translation is available to read via this weblink. The original French text follows this introduction.
A contemporary caricature of the great writer
MÉMOIRES D’UN FOU
TABLE DES MATIÈRES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
À toi mon cher Alfred
ces pages sont dédiées et données.
Elles renferment une âme tout entière. Est-ce la mienne ? est-ce celle d’un autre ? J’avais d’abord voulu faire un roman intime, où le scepticisme serait poussé jusqu’aux dernières bornes du désespoir ; mais peu à peu, en écrivant, l’impression personnelle perça à travers la fable, l’âme remua la plume et l’écrasa.
J’aime donc mieux laisser cela dans le mystère des conjectures ; pour toi, tu n’en feras pas.
Seulement tu croiras peut-être, en bien des endroits, que l’expression est forcée et le tableau assombri à plaisir ; rappelle-toi que c’est un fou qui a écrit ces pages, et, si le mot paraît souvent surpasser le sentiment qu’il exprime, c’est que, ailleurs, il a fléchi sous le poids du cœur.
Adieu, pense à moi et pour moi.
I
Pourquoi écrire ces pages ? — À quoi sont-elles bonnes ? Qu’en sçais-je moi-même ? Cela est assez sot, à mon gré, d’aller demander aux hommes le motif de leurs actions et de leurs écrits. — Sçavez-vous vous-même pourquoi vous avez ouvert les misérables feuilles que la main d’un fou va tracer ?
Un fou ! cela fait horreur. Qu’êtes-vous, vous lecteur ? Dans quelle catégorie te ranges-tu, dans celle des sots ou celle des fous ? — Si l’on te donnait à choisir, ta vanité préférerait encore la dernière condition. Oui, encore une fois, à quoi est-il bon, je le demande en vérité, un livre qui n’est ni instructif, ni amusant ni chimique ni philosophique ni agricultural ni élégiaque, un livre qui ne donne aucune recette ni pour les moutons ni pour les puces, qui ne parle ni des chemins de fer, ni de la Bourse, ni des replis intimes du cœur humain, ni des habits moyen âge, ni de Dieu, ni du diable, mais qui parle d’un fou, c’est-à-dire, le monde, ce grand idiot, qui tourne depuis tant de siècles dans l’espace sans faire un pas, et qui hurle, et qui bave et qui se déchire lui-même ?
Je ne sais pas plus que vous ce que vous allez lire, car ce n’est point un roman ni un drame avec un plan fixe, ou une seule idée préméditée, avec des jalons pour faire serpenter la pensée dans des allées tirées au cordeau.
Seulement je vais mettre sur le papier tout ce qui me viendra à la tête, mes idées avec mes souvenirs, mes impressions, mes rêves, mes caprices, tout ce qui passe dans la pensée et dans l’âme ; du rire et des pleurs, du blanc et du noir, des sanglots partis d’abord du cœur et étalés comme de la pâte dans des périodes sonores, et des larmes délayées dans des métaphores romantiques. Il me pèse cependant à penser que je vais écraser le bec à un paquet de plumes, que je vais user une bouteille d’encre, que je vais ennuyer le lecteur et m’ennuyer moi-même ; j’ai tellement pris l’habitude du rire et du scepticisme, qu’on y trouvera, depuis le commencement jusqu’à la fin une plaisanterie perpétuelle, et les gens qui aiment à rire pourront à la fin rire de l’auteur et d’eux-mêmes.
On y verra comment il faut croire au plan de l’univers, aux devoirs moraux de l’homme, à la vertu et à la philanthropie, mot que j’ai envie de faire inscrire sur mes bottes, quand j’en aurai, afin que tout le monde puisse le lire et l’apprendre par cœur, les corps les plus petits, les plus rampants, les plus près du ruisseau.
On aurait tort de voir dans ceci autre chose que les récréations d’un pauvre fou ! Un fou !
Et vous, lecteur, vous venez peut-être de vous marier ou de payer vos dettes ?
II
Je vais donc écrire l’histoire de ma vie. — Quelle vie ! Mais ai-je vécu ? je suis jeune, j’ai le visage sans ride et le cœur sans passion. — Oh ! comme elle fut calme, comme elle paraît douce et heureuse, tranquille et pure. Oh ! oui, paisible et silencieuse comme un tombeau dont l’âme serait le cadavre.
À peine ai-je vécu : je n’ai point connu le monde, c’est-à-dire je n’ai point de maîtresses, de flatteurs, de domestiques, d’équipages ; je ne suis pas entré, comme on dit, dans la société, car elle m’a paru toujours fausse et sonore et couverte de clinquant, ennuyeuse et guindée.
Or, ma vie, ce ne sont pas des faits ; ma vie, c’est une pensée.
Quelle est donc cette pensée qui m’amène maintenant, à l’âge où tout le monde sourit, se trouve heureux, où l’on se marie, où l’on aime ; à l’âge où tant d’autres s’enivrent de toutes les amours et de toutes les gloires, alors que tant de lumières brillent et que les verres sont remplis au festin, à me trouver seul et nu, froid à toute inspiration, à toute poésie, me sentant mourir et riant cruellement de ma lente agonie, comme cet épicurien qui se fit ouvrir les veines, se baigna dans un bain parfumé et mourut en riant, comme un homme qui sort ivre d’une orgie qui l’a fatigué ?
Oh ! comme elle fut longue cette pensée ! Comme une hydre, elle me dévora sous toutes ses faces. Pensée de deuil et
d’amertume, pensée de bouffon qui pleure, pensée de philosophe qui médite…
Oh ! oui ! combien d’heures se sont écoulées dans ma vie, longues et monotones, à penser, à douter ! combien de journées d’hiver la tête baissée devant mes tisons blanchis aux pâles reflets du soleil couchant, combien de soirées d’été par les champs au crépuscule à regarder les nuages s’enfuir et se déployer, les blés se plier sous la brise, entendre les bois frémir et écouter la nature qui soupire dans les nuits !
Oh ! comme mon enfance fut rêveuse, comme j’étais un pauvre fou sans idées fixes, sans opinions positives ! Je regardais l’eau couler entre les massifs d’arbres qui penchent leur chevelure de feuilles et laissent tomber des fleurs, je contemplais de dedans mon berceau la lune sur son fond d’azur qui éclairait ma chambre et dessinait des formes étranges sur les murailles ; j’avais des extases devant un beau soleil ou une matinée de printemps avec son brouillard blanc, ses arbres fleuris, ses marguerites en fleurs.
J’aimais aussi, — et c’est un de mes plus tendres et délicieux souvenirs, — à regarder la mer, les vagues mousser l’une sur l’autre, la lame se briser en écume, s’étendre sur la plage et crier en se retirant sur les cailloux et les coquilles.
Je courais sur les rochers, je prenais le sable de l’Océan que je laissais s’écouler au vent entre mes doigts, je mouillais des varechs et j’aspirais à pleine poitrine cet air salé et frais de l’océan qui vous pénètre l’âme de tant d’énergie, de poétiques et larges pensées ; je regardais l’immensité, l’espace, l’infini, et mon âme s’abîmait devant cet horizon sans bornes.
Oh ! mais ce n’est pas [là] qu’est l’horizon sans bornes ! Le gouffre immense, oh ! non, un plus large et plus profond abîme s’ouvrit devant moi. Ce gouffre-là n’a point de tempête ; s’il y avait une tempête, il serait plein… et il est vide !
J’étais gai et riant, aimant la vie et ma mère. Pauvre mère !
Je me rappelle encore mes petites joies à voir les chevaux courir sur la route, à voir la fumée de leur haleine et la sueur inonder leurs harnois, j’aimais le trot monotone et cadencé qui fait osciller les soupentes ; et puis quand on s’arrêtait, tout se taisait dans les champs. On voyait la fumée sortir de leurs naseaux, la voiture ébranlée se raffermissait sur ses ressorts, le vent sifflait sur les vitres ; et c’était tout…
Oh ! comme j’ouvrais aussi de grands yeux sur la foule en habit de fête, joyeuse, tumultueuse, avec des cris, mer d’hommes orageuse, plus colère encore que la tempête et plus sotte que sa furie.
J’aimais les chars, les chevaux, les armées, les costumes de guerre, les tambours battants, le bruit la poudre et les canons roulant sur le pavé des villes.
Enfant, j’aimais ce qui [se] voit ; adolescent, ce qui se sent ; homme, je n’aime plus rien.
Et cependant, combien de choses j’ai dans l’âme, combien de forces intimes et combien d’océans de colère et d’amours se heurtent, se brisent dans ce cœur si faible, si débile si lassé si épuisé !
On me dit de reprendre à la vie, de me mêler à la foule !… Et comment la branche cassée peut-elle porter des fruits ? comment la feuille arrachée par les vents et traînée dans la poussière peut-elle reverdir ? Et pourquoi, si jeune, tant d’amertume ? Que sais-je ? il était peut-être dans ma destinée de vivre ainsi, lassé avant d’avoir porté le fardeau, haletant avant d’avoir couru.
J’ai lu, j’ai travaillé dans l’ardeur de l’enthousiasme, j’ai écrit. Oh ! comme j’étais heureux alors, comme ma pensée dans son délire s’envolait haut dans ces régions inconnues aux hommes, où il n’y a ni monde ni planètes ni soleils ! J’avais un infini plus immense s’il est possible que l’infini de Dieu, où la poésie se berçait et déployait ses ailes dans une atmosphère d’amour et d’extase ; et puis il fallait redescendre de ces régions sublimes vers les mots, et comment rendre par la parole cette harmonie qui s’élève dans le cœur du poète, et les pensées de géant qui font ployer les phrases comme une main forte et gonflée fait crever le gant qui la couvre ?
Là encore, la déception ; car nous touchons à la terre, à cette terre de glace, où tout feu meurt, où toute énergie faiblit ! Par quels échelons descendre de l’infini au positif ? Par quelle gradation la pensée s’abaisse-t-elle sans se briser ? Comment rapetisser ce géant qui embrasse l’infini ?
Alors j’avais des moments de tristesse et de désespoir, je sentais ma force qui me brisait et cette faiblesse dont j’avais honte, car la parole n’est qu’un écho lointain et affaibli de la pensée ; Je maudissais mes rêves les plus chers et mes heures silencieuses passées sur la limite de la création ; Je sentais quelque chose de vide et d’insatiable qui me dévorait.
Lassé de la poésie, je me lançai dans le champ de la méditation.
Je fus épris d’abord de cette étude imposante qui se propose l’homme pour but, et qui veut se l’expliquer, qui va jusqu’à disséquer des hypothèses et à discuter sur les suppositions les plus abstraites et à peser géométriquement les mots les plus vides.
L’homme, grain de sable jeté dans l’infini par une main inconnue, pauvre insecte aux faibles pattes qui veut se retenir sur le bord du gouffre à toutes les branches, qui se rattache à la vertu, à l’amour, à l’égoïsme, à l’ambition, et qui fait des vertus de tout cela pour mieux s’y tenir, qui se cramponne à Dieu, et qui faiblit toujours, lâche les mains et tombe…
Homme qui veut comprendre ce qui n’est pas et faire une science du néant ; homme, âme faite à l’image de Dieu et dont le génie sublime s’arrête à un brin d’herbe et ne peut franchir le problème d’un grain de poussière !
Et la lassitude me prit ; je vins à douter de tout. Jeune, j’étais vieux ; mon cœur avait des rides et en voyant des vieillards encore vifs, pleins d’enthousiasme et de croyances, je riais amèrement sur moi-même, si jeune, si désabusé de la vie, de l’amour, de la gloire, de Dieu, de tout ce qui est, de tout ce qui peut être.
J’eus cependant une horreur naturelle avant d’embrasser cette foi au néant ; au bord du gouffre, je fermai les yeux, j’y tombai.
Je fus content, je n’avais plus de chute à faire, j’étais froid et calme comme la pierre d’un tombeau. Je croyais trouver le bonheur dans le doute, insensé que j’étais ! On y roule dans un vide incommensurable. Ce vide-là est immense et fait dresser les cheveux d’horreur quand on s’approche du bord.
Du doute de Dieu j’en vins au doute de la vertu, fragile idée que chaque siècle a dressée comme il a pu sur l’échafaudage des lois, plus vacillant encore.
Je vous conterai plus tard toutes les phases de cette vie morne et méditative passée au coin du feu les bras croisés, avec un éternel bâillement d’ennui, seul pendant tout un jour, et tournant de temps [en temps] mes regards sur la neige des toits voisins, sur le soleil couchant avec ses jets de pâle lumière sur le pavé de ma chambre, ou sur une tête de mort jaune, édenteée et grimaçant sans cesse sur ma cheminée, symbole de la vie et comme elle froide et railleuse.
Plus tard, vous lirez peut-être toutes les angoisses de ce cœur si battu, si navré d’amertume. Vous sçaurez les aventures de cette vie si paisible et si banale, si remplie de sentiments, si vide de faits.
Et vous me direz ensuite si tout n’est pas une dérision et une moquerie, si tout ce qu’on chante dans les écoles, tout ce qu’on délaie dans les livres, tout ce qui se voit, se sent, se parle, si tout ce qui existe…
Je n’achève pas tant j’ai d’amertume à le dire. Eh ! bien, si tout cela enfin n’est pas de la pitié, de la fumée, du néant !
III
Je fus au collège dès l’âge de dix ans et j’y contractai de bonne heure une profonde aversion pour les hommes. Cette société d’enfants est aussi cruelle pour ses victimes que l’autre petite société, celle des hommes.
Même injustice de la foule, même tyrannie des préjugés et de la force, même égoïsme quoi qu’on ait dit sur le désintéressement et la fidélité de la jeunesse. Jeunesse ! âge de folie et de rêv
es, de poésie et de bêtise, synonymes dans la bouche des gens qui jugent le monde sainement. J’y fus froissé dans tous mes goûts : dans la classe pour mes idées, aux récréations pour mes penchants de sauvagerie solitaire. Dès lors, j’étais un fou.
J’y vécus donc seul et ennuyé, tracassé par mes maîtres et raillé par mes camarades. J’avais l’humeur railleuse et indépendante, et ma mordante et cynique ironie n’épargnait pas plus le caprice d’un seul que le despotisme de tous.
Je me vois encore, assis sur les bancs de la classe, absorbé dans mes rêves d’avenir, pensant à ce que l’imagination d’un enfant peut rêver de plus sublime, tandis que le pédagogue se moquait de mes vers latins, que mes camarades me regardaient en ricanant. Les imbéciles ! eux, rire de moi ! eux, si faibles, si communs, au cerveau si étroit ; moi, dont l’esprit se noyait sur les limites de la création, qui étais perdu dans tous les mondes de la poésie, qui me sentais plus grand qu’eux tous, qui recevais des jouissances infinies et qui avais des extases célestes devant toutes les révélations intimes de mon âme !
Moi qui me sentais grand comme le monde et qu’une seule de mes pensées si elle eût été de feu comme la foudre, eût pu réduire en poussière ; Pauvre fou !
Je me voyais jeune, à vingt ans, entouré de gloire, je rêvais de lointains voyages dans les contrées du Sud ; je voyais l’Orient et ses sables immenses, ses palais que foulent les chameaux et leurs clochettes d’airain ; je voyais les cavales bondir vers l’horizon rougi par le soleil ; je voyais des vagues bleues, un ciel pur, un sable d’argent ; je sentais le parfum de ces Océans tièdes du Midi ; et puis près de moi, sous une tente à l’ombre d’un aloès aux larges feuilles, quelque femme à la peau brune, au regard ardent, qui m’entourait de ses deux bras et me parlait la langue des houris.

 Bouvard and Pecuchet
Bouvard and Pecuchet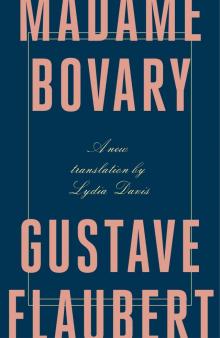 Madame Bovary
Madame Bovary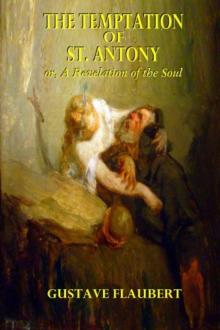 The Temptation of St. Antony
The Temptation of St. Antony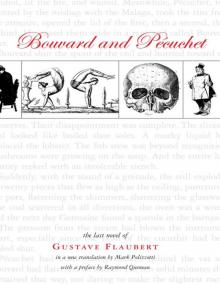 Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 1
Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 1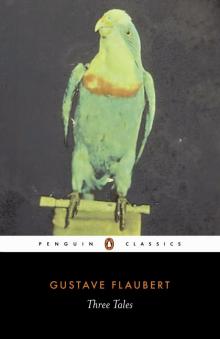 Three Tales
Three Tales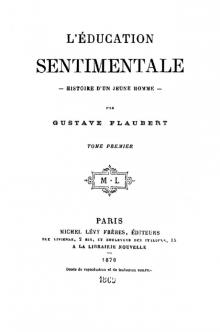 Education sentimentale. English
Education sentimentale. English Madame Bovary (Modern Library)
Madame Bovary (Modern Library)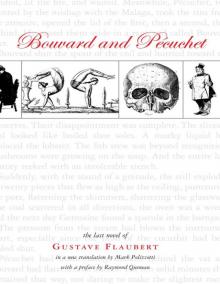 Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 2
Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 2 Sentimental Education; Or, The History of a Young Man. Volume 1
Sentimental Education; Or, The History of a Young Man. Volume 1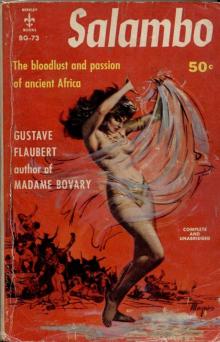 Salammbo
Salammbo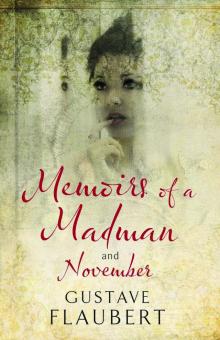 Memoirs of a Madman and November
Memoirs of a Madman and November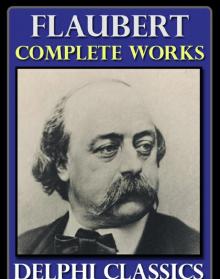 Complete Works of Gustave Flaubert
Complete Works of Gustave Flaubert