- Home
- Gustave Flaubert
Complete Works of Gustave Flaubert Page 2
Complete Works of Gustave Flaubert Read online
Page 2
Le soleil s’abaissait dans le sable, les chamelles et les juments dormaient, l’insecte bourdonnait à leurs mamelles, le vent du soir passait près de nous.
Et la nuit venue, quand cette lune d’argent jetait ses regards pâles sur le désert, que les étoiles brillaient sur le ciel d’azur, alors, dans le silence de cette nuit chaude et embaumée, je rêvais des joies infinies, des voluptés qui sont du ciel.
Et c’était encore la gloire, avec ses bruits de mains, ses fanfares vers le ciel, ses lauriers, sa poussière d’or jetée aux vents ; c’était un brillant théâtre avec des femmes parées, des diamants aux lumières, un air lourd, des poitrines haletantes ; puis un recueillement religieux, des paroles dévorantes comme l’incendie, des pleurs, du rire, des sanglots, l’enivrement de la gloire, des cris d’enthousiasme, le trépignement de la foule. Quoi ! de la vanité, du bruit, du néant.
Enfant, j’ai rêvé l’amour ; jeune homme la gloire ; homme, la tombe, ce dernier amour de ceux qui n’en ont plus.
Je percevais aussi l’antique époque des siècles qui ne sont plus et des races couchées sous l’herbe ; je voyais la bande de pèlerins et de guerriers marcher vers le Calvaire, s’arrêter dans le désert, mourant de faim, implorant ce Dieu qu’ils allaient chercher, et lassée de ses blasphèmes, marcher toujours vers cet horizon sans bornes ; puis, lasse, haletante, arriver enfin au but de son voyage, désespérée et vieille, pour embrasser quelques pierres arides, hommage du monde entier.
Je voyais les chevaliers courir sur les chevaux.
La nuit encore, dans la sombre cathédrale, toute la nef ornée d’une guirlande de peuples qui montent vers la voûte, dans les galeries, avec des chants ; des lumières qui resplendissent sur les vitraux, et dans la nuit de Noël toute la vieille ville avec ses toits aigus couverts de neige, s’illuminer et chanter.
Mais c’était Rome que j’aimais, la Rome impériale, cette belle reine se roulant dans l’orgie, salissant ses nobles vêtements du vin de la débauche, plus fière de ses vices qu’elle ne l’était de ses vertus. Néron ! Néron, avec ses chars de diamant volant dans l’arène, ses mille voitures, ses amours de tigre et ses festins de géant.
Loin des classiques leçons, je me reportais vers tes immenses voluptés, tes illuminations sanglantes, tes divertissements qui brûlent Rome.
Et bercé dans ces vagues rêveries, ces songes sur l’avenir, emporté par cette pensée aventureuse échappée comme une cavale sans frein qui franchit les torrents, escalade les monts et vole dans l’espace, je restais des heures entières la tête dans mes mains à regarder le plancher de mon étude ou une araignée jeter sa toile sur la chaire de notre maître ; et quand je me réveillais avec un grand œil béant, on riait de moi, le plus paresseux de tous, qui jamais n’aurait une idée positive, qui ne montrait aucun penchant pour aucune profession, qui serait inutile dans ce monde où il faut que chacun aille prendre sa part du gâteau, et qui enfin ne serait jamais bon à rien, tout au plus à faire un bouffon, un montreur d’animaux ou un faiseur de livres.
(Quoique d’une excellente santé, mon genre d’esprit perpétuellement froissé par l’existence que je menais et par le contact des autres avait occasionné en moi une irritation nerveuse qui me rendait véhément et emporté comme le taureau malade de la piqûre des insectes. J’avais des rêves, des cauchemars affreux.)
Oh !… la triste et maussade époque ! Je me vois encore errant, seul, dans les longs corridors blanchis de mon collège, à regarder les hiboux et les corneilles s’envoler des combles de la chapelle, ou bien, couché dans ces mornes dortoirs éclairés par la lampe dont l’huile se gelait. Dans les nuits, j’écoutais longtemps le vent qui soufflait lugubrement dans les longs appartements vides, et qui sifflait dans les serrures en faisant trembler les vitres dans leurs châssis ; j’entendais les pas de l’homme de ronde qui marchait lentement avec sa lanterne, et, quand il venait près de moi, je faisais semblant d’être endormi et je m’endormais en effet, moitié dans les rêves, moitié dans les pleurs.
IV
C’étaient d’effroyables visions à rendre fou de terreur.
J’étais couché dans la maison de mon père ; tous les meubles étaient conservés, mais tout ce qui m’entourait cependant avait une teinte noire. C’était une nuit d’hiver, et la neige jetait une clarté blanche dans ma chambre. Tout à coup la neige se fondit et les herbes et les arbres prirent une teinte rousse et brûlée, comme si un incendie eût éclairé mes fenêtres ; j’entendis des bruits de pas, on montait l’escalier ; un air chaud, une vapeur fétide monta jusqu’à moi. Ma porte s’ouvrit d’elle-même, on entra. Ils étaient beaucoup, peut-être [sept à huit], je n’eus pas le temps de les compter. Ils étaient petits ou grands, couverts de barbes noires et rudes, sans armes, mais tous avaient une lame d’acier entre les dents, et comme ils s’approchèrent en cercle autour de mon berceau leurs dents vinrent à claquer et ce fut horrible.
Ils écartèrent mes rideaux blancs et chaque doigt laissait une trace de sang ; ils me regardèrent avec de grands yeux fixes et sans paupières ; je les regardai aussi, je ne pouvais faire aucun mouvement, je voulais crier.
Il me sembla alors que la maison se levait de ses fondements, comme si un levier l’eût soulevée.
Ils me regardèrent ainsi longtemps, puis ils s’écartèrent, et je vis que tous avaient un côté du visage sans peau et qui saignait lentement. Ils soulevèrent tous mes vêtements et tous avaient du sang ; ils se mirent à manger, et le pain qu’ils rompirent laissait échapper du sang qui tombait goutte à goutte ; et ils se mirent à rire, comme le râle d’un mourant.
Puis, quand ils n’y furent plus, tout ce qu’ils avaient touché, les lambris, l’escalier, le plancher, tout cela était rougi par eux.
J’avais un goût d’amertume dans le cœur, il me sembla que j’avais mangé de la chair, et j’entendis un cri prolongé, rauque, aigu et les fenêtres et les portes s’ouvrirent lentement, et le vent les faisait battre et crier, comme une chanson bizarre dont chaque sifflement me déchirait la poitrine avec un stylet.
Ailleurs, – c’était dans une campagne verte et émaillée de fleurs, le long d’un fleuve ; – j’étais avec ma mère qui marchait du côté de la rive, elle tomba. Je vis l’eau écumer, des cercles s’agrandir et disparaître tout à coup ; l’eau reprit son cours, et puis je n’entendis plus que le bruit de l’eau qui passait entre les joncs et faisait ployer les roseaux.
Tout à coup, ma mère m’appela : Au secours !… au secours ! ô mon pauvre enfant, au secours ! à moi !
Je me penchai à plat ventre sur l’herbe pour regarder : je ne vis rien ; les cris continuèrent.
Une force invincible m’attachait sur la terre, et j’entendais les cris : je me noye ! je me noye ! à mon secours !
L’eau coulait, coulait limpide, et cette voix que j’entendais du fond du fleuve m’abîmait de désespoir et de rage...
V
Voilà donc comme j’étais, rêveur, insouciant avec l’humeur indépendante et railleuse, me bâtissant une destinée et rêvant à toute la poésie d’une existence pleine d’amour, vivant aussi sur mes souvenirs, autant qu’à seize ans on peut en avoir.
Le collège m’était antipathique. Ce serait une curieuse étude que ce profond dégoût des âmes nobles et élevées manifesté de suite par le contact et le froissement des hommes. Je n’ai jamais aimé une vie réglée, des heures fixes, une existence d’horloge où il faut que la pensée s’arrête avec la cloche, où tout est remonté d’avance, pour des siècles et des générations. Cette régularité sans doute peut convenir au plus grand nombre, mais pour le pauvre enfant qui se nourrit de poésie, de rêves et de chimères, qui pense à l’amour et à toutes les balivernes, c’est l’éveiller sans cesse de ce songe sublime, c’est ne pas lui laisser ni moment de repos, c’est l’étouffer en le ramenant dans notre atmosphère de matérialisme et de bon sens, dont il a horreur et dégoût.
J’allais à l’écart avec un livre de vers, un roman, de la poésie, quelque chose qui fasse tressaillir ce cœur de jeune homme, vier
ge de sensations et si désireux d’en avoir.
Je me rappelle avec quelle volupté je dévorais alors les pages de Byron et de Werther ; avec quels transports je lus Hamlet, Roméo, et les ouvrages les plus brûlants de notre époque, toutes ces œuvres enfin qui fondent l’âme en délices, ou la brûlent d’enthousiasme.
Je me nourris donc de cette poésie âpre du Nord, qui retentit si bien comme les vagues de la mer, dans les œuvres de Byron. Souvent j’en retenais, à la première lecture, des fragments entiers, et je me les répétais à moi-même, comme une chanson qui vous a charmé et dont la mélodie vous poursuit toujours.
Combien de fois n’ai-je pas dit le commencement du “Giaour” : Pas un souffle d’air, ou bien dans “Childe Harold” : Jadis dans l’antique Albion, et : Ô mer ! je t’ai toujours aimée. La platitude de la traduction française disparaissait devant les pensées seules, comme si elles eussent eu un style à elles sans les mots eux-mêmes.
Ce caractère de passion brûlante, joint à une si profonde ironie, devait agir fortement sur une nature ardente et vierge. Tous ces échos inconnus à la somptueuse dignité des littératures classiques avaient pour moi un parfum de nouveauté, un attrait qui m’attirait sans cesse vers cette poésie géante, qui vous donne le vertige et nous fait tomber dans le gouffre sans fond de l’infini.
Je m’étais donc faussé le goût et le cœur, comme disaient mes professeurs, et parmi tant d’êtres aux penchants si ignobles, mon indépendance d’esprit m’avait fait estimer le plus dépravé de tous ; j’étais ravalé au plus bas rang par la supériorité même. À peine si on me cédait l’imagination, c’est-à-dire, selon eux, une exaltation de cerveau voisine de la folie.
Voilà quelle fut mon entrée dans la société, et l’estime que je m’y attirai.
VI
Si l’on calomniait mon esprit et mes principes on n’attaquait pas mon cœur, car j’étais bon alors, et les misères d’autrui m’arrachaient des larmes.
Je me souviens que, tout enfant j’aimais à vider mes poches dans celles du pauvre. De quel sourire ils accueillaient mon passage et quel plaisir aussi j’avais à leur faire du bien !
C’est une volupté qui m’est depuis longtemps inconnue, car maintenant j’ai le cœur sec, les larmes se sont séchées. Mais malheur aux hommes qui m’ont rendu corrompu et méchant de bon et de pur que j’étais ! Malheur à cette aridité de la civilisation qui dessèche et étiole tout ce qui s’élève au soleil de la poésie et du cœur ! Cette vieille société corrompue qui a tant séduit et tant usé, ce vieux juif cupide mourra de marasme et d’épuisement sur ces tas de fumier qu’il appelle ses trésors, sans poète pour chanter sa mort, sans prêtre pour lui fermer les yeux, sans or pour son mausolée, car il aura tout usé pour ses vices.
VII
Quand donc finira cette société abâtardie par toutes les débauches, débauches d’esprit, de corps et d’âme ?
Alors, il y aura sans doute une joie sur la terre, quand ce vampire menteur et hypocrite qu’on appelle civilisation viendra à mourir ; on quittera le manteau royal, le sceptre, les diamants, le palais qui s’écroule, la ville qui tombe, pour aller rejoindre la cavale et la louve.
Après avoir passé sa vie dans les palais et usé ses pieds sur les dalles des grandes villes, l’homme ira mourir dans les bois.
La terre sera séchée par les incendies qui l’ont brûlée et toute pleine de la poussière des combats, le souffle de désolation, qui a passé sur les hommes aura passé sur elle, et elle ne donnera plus que des fruits amers et des roses d’épines, et les races s’éteindront au berceau comme les plantes battues par les vents qui meurent avant d’avoir fleuri.
Car il faudra bien que tout finisse et que la terre s’use à force d’être foulée ; Car l’immensité doit être lasse enfin de ce grain de poussière qui fait tant de bruit et trouble la majesté du néant. Il faudra que l’or s’épuise à force de passer dans les mains et de corrompre ; il faudra bien que cette vapeur de sang s’apaise, que le palais s’écroule sous le poids des richesses qu’il recèle, que l’orgie finisse et qu’on se réveille.
Alors il y aura un rire immense de désespoir, quand les hommes verront ce vide, quand il faudra quitter la vie pour la mort, pour la mort qui mange, qui a faim toujours. Et tout craquera pour s’écrouler dans le néant, et l’homme vertueux maudira sa vertu et le vice battra des mains.
Quelques hommes encore errants dans une terre aride s’appelleront mutuellement ; ils iront les uns vers les autres, et ils reculeront d’horreur, effrayés d’eux-mêmes, et ils mourront. Que sera l’homme alors, lui qui est déjà plus féroce que les bêtes fauves et plus vil que les reptiles ? Adieu pour jamais, chars éclatants, fanfares et renommées ; adieu au monde, à ses palais, à ses mausolées, aux voluptés du crime et aux joies de la corruption ! La pierre tombera tout à coup, écrasée par elle-même, et l’herbe poussera dessus. Et les palais, les temples, les pyramides, les colonnes, mausolées du roy, cercueil du pauvre, charogne du chien, tout cela sera à la même hauteur sous le gazon de la terre.
Alors, la mer sans digues battra en repos les rivages et ira baigner ses flots sur la cendre encore fumante des cités ; les arbres pousseront, verdiront, sans une main pour les casser et les briser ; les fleuves couleront dans des prairies émaillées, la nature sera libre, sans homme pour la contraindre, et cette race sera éteinte, car elle était maudite dès son enfance.
Triste et bizarre époque que la nôtre ! Vers quel océan ce torrent d’iniquités coule-t-il ? Où allons-nous dans une nuit si profonde ? Ceux qui veulent palper ce monde malade se retirent vite, effrayés de la corruption qui s’agite dans ses entrailles.
Quand Rome se sentit à son agonie, elle avait au moins un espoir, elle entrevoyait derrière le linceul la croix radieuse, brillant sur l’éternité. Cette religion a duré deux mille ans et voilà qu’elle s’épuise, qu’elle ne suffit plus, et qu’on s’en moque ; voilà ses églises qui tombent, ses cimetières tassés de morts et qui regorgent.
Et nous, quelle religion aurons-nous ? Être si vieux que nous le sommes et marcher encore dans le désert comme les Hébreux qui fuyaient d'Égypte !
Où sera la Terre Promise ?
Nous avons essayé de tout et nous renions tout sans espoir ; et puis une étrange cupidité nous a pris dans l'âme et l'humanité, il y a une inquiétude immense qui nous ronge, il y a un vide dans notre foule ; nous sentons autour de nous un froid de sépulcre.
L’humanité s’est prise à tourner des machines, et voyant l’or qui en ruisselait, elle s’est écriée : C’est Dieu ! et ce Dieu-là, elle le mange. Il y a : C’est que tout est fini, adieu ! adieu ! du vin avant de mourir ! Chacun se rue ou le pousse son instinct, le monde fourmille comme les insectes sur un cadavre, les poètes passent sans avoir le temps de sculpter leurs pensées, à peine s’ils les jettent sur des feuilles et les feuilles volent ; tout brille et tout retentit dans cette mascarade, sous ses royautés d’un jour et ses sceptres de carton, l’or roule, le vin ruisselle, la débauche froide lève sa robe et remue… horreur ! horreur !
Et puis il y a sur tout cela un voile dont chacun prend sa part et se cache le plus qu’il peut.
Dérision ! horreur ! horreur !
VIII
Et il y a des jours où j’ai une lassitude immense, et un sombre ennui m’enveloppe comme un linceul partout où je vais ; ses plis m’embarrassent et me gênent, la vie me pèse comme un remords. Si jeune et si lassé de tout, quand il y en a qui sont vieux et encore pleins d’enthousiasme ! et moi, je suis si tombé, si désenchanté ! que faire ? La nuit, regarder la lune qui jette sur mes lambris ses clartés tremblantes comme un large feuillage, et, le jour, le soleil dorant les toits voisins ? Est-ce là vivre ? Non, c’est la mort moins le repos du sépulcre.
Et j’ai des petites joies à moi seul, des réminiscences enfantines qui viennent encore me réchauffer dans mon isolement, comme des reflets de soleil couchant par les barreaux d’une prison. Un rien, la moindre circonstance, un jour pluvieux, un grand soleil, une fleur, un vieu
x meuble, me rappellent une série de souvenirs qui passent tous, confus, effacés comme des ombres. Jeux d’enfants sur l’herbe au milieu des marguerites dans les prés, derrière la haie fleurie, le long de la vigne aux grappes dorées, sur la mousse brune et verte, sous les larges feuilles, les frais ombrages ; souvenirs calmes et riants comme un souvenir du premier âge, vous passez près de moi comme des roses flétries.
La jeunesse, ses bouillants transports, ses instincts confus du monde et du cœur, ses palpitations d’amour, ses larmes, ses cris ! Amour du jeune homme, ironies de l’âge mûr. Vous revenez souvent avec vos couleurs sombres ou ternes, fuyant poussées les unes par les autres, comme les ombres des morts qui passent en courant sur les murs dans les nuits d’hiver. Et je tombe souvent en extases devant le souvenir de quelque bonne journée passée depuis bien longtemps, journée folle et joyeuse avec des éclats et des rires qui vibrent encore à mes oreilles, et qui palpite encore de gaieté et qui me fait sourire d’amertume. C’était quelque course sur un cheval, bondissant et couvert d’écume, quelque promenade bien rêveuse sous une large allée couverte d’ombre, à regarder l’eau couler sur les cailloux ; ou une contemplation d’un beau soleil resplendissant avec ses gerbes de feu et ses auréoles rouges. Et j’entends encore le galop du cheval, ses naseaux qui fument ; j’entends l’eau qui glisse, la feuille qui tremble, le vent qui courbe les blés comme une mer.
D’autres sont mornes et froids comme des journées pluvieuses, des souvenirs amers et cruels qui reviennent aussi ; des heures de calvaire passées à pleurer sans espoir, et puis à rire forcément pour chasser ces larmes qui cachent les yeux, les sanglots qui couvrent la voix.
J’ai resté bien des jours, bien des ans, assis à ne penser à rien, ou à tout, abîmé dans l’infini que je voulais embrasser, et qui me dévorait !
J’entendais la pluie tomber dans les gouttières, les cloches sonner en pleurant ; je voyais le soleil se coucher et la nuit venir ; la nuit dormeuse qui vous apaise ; et puis le jour reparaissait, toujours le même avec ses ennuis, son même nombre d’heures à vivre et que je voyais mourir avec joie.

 Bouvard and Pecuchet
Bouvard and Pecuchet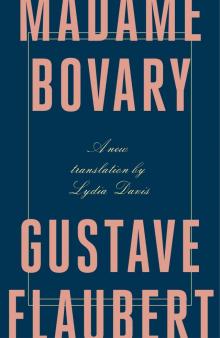 Madame Bovary
Madame Bovary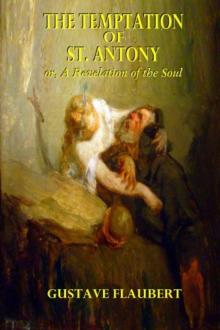 The Temptation of St. Antony
The Temptation of St. Antony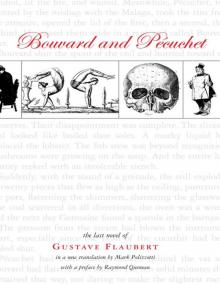 Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 1
Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 1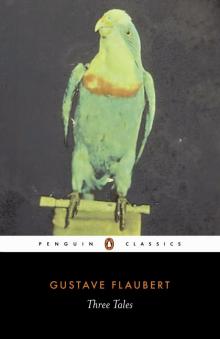 Three Tales
Three Tales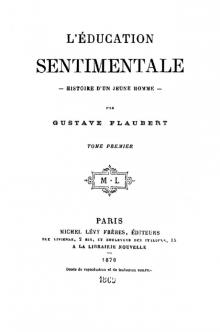 Education sentimentale. English
Education sentimentale. English Madame Bovary (Modern Library)
Madame Bovary (Modern Library)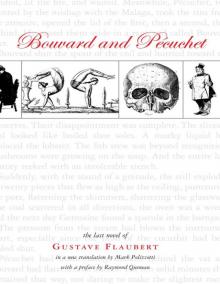 Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 2
Bouvard and Pécuchet: A Tragi-comic Novel of Bourgeois Life, part 2 Sentimental Education; Or, The History of a Young Man. Volume 1
Sentimental Education; Or, The History of a Young Man. Volume 1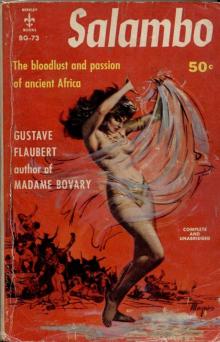 Salammbo
Salammbo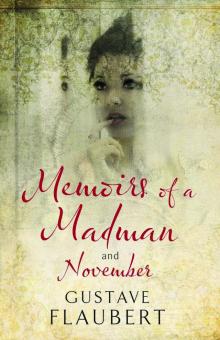 Memoirs of a Madman and November
Memoirs of a Madman and November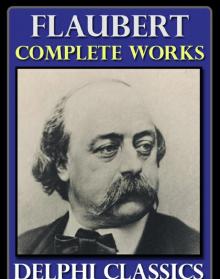 Complete Works of Gustave Flaubert
Complete Works of Gustave Flaubert